Critique du Rapport Sukhdev sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité
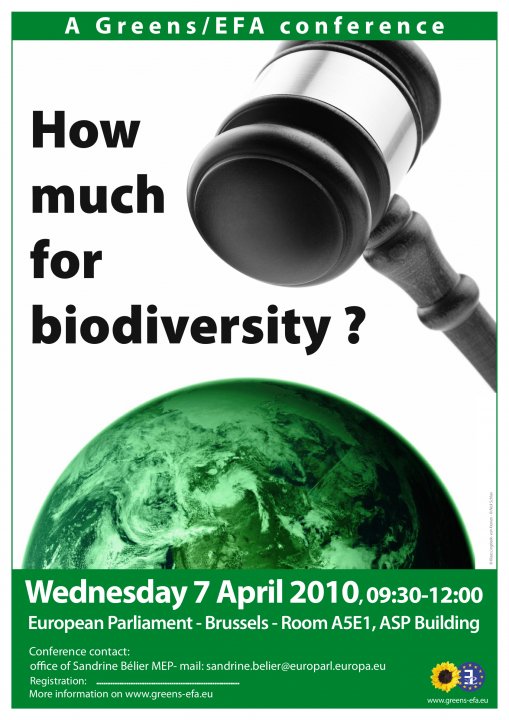 Les gros chiffres du rapport sur la biodiversité
Les gros chiffres du rapport sur la biodiversité
« Les gros chiffres impressionnent. L’actuelle érosion des biotopes terrestres – forêts, océans, sols etc. –, jusqu’ici capables de s’auto-entretenir, nous coûte entre 1 350 et 3 100 milliards d’euros chaque année – en comparaison, le FMI estime à 1 150 millions d’euros les pertes bancaires pendant la récente crise financière. En diminuant par deux le rythme de la déforestation d’ici à 2030, les réductions d’émission de CO2 par année diminueraient de 2 600 milliards d’euros les dégâts causés par le réchauffement – sans compter les services de captation de CO2 rendus par les forêts. »(1). L’expression est de Pavan Sukhdev, un économiste indien qui a présenté le 20 octobre au sommet sur la biodiversité de Nagoya (Japon) le rapport qualifié de « Stern bis » sur l’économie de la biodiversité (pour un résumé voir : The Economics of Ecosystems and Biodiversity sur http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=bYhDohL_TuM%3d&tabid=924&mid=1813 ).
La logique économique du rapport
La logique du rapport est d’évaluer en flux monétaire les services rendus par les écosystèmes. Actuellement, il s’agit de biens publics (ou semi public) au sens économique du terme, c’est-à-dire se caractérisant par la non-rivalité dans leur consommation (par exemple, le fait qu’une personne se promène dans une forêt n’empêche pas un tiers de faire de même) et/ou la non-exclusion (on ne peut exclure quelqu’un de la consommation des services d’une forêt ). Sur ce point, il convient de souligner que ces propriétés découlent le plus souvent des caractéristiques intrinsèques de ces biens que de leur situation juridique. En effet, une forêt ou une mer peut parfaitement être privatisée de telle sorte que l’exclusion de tiers de la consommation de ces biens soit une réalité juridique. Néanmoins, faire respecter ce droit de propriété exige de déployer des moyens importants. Pour être concret: poster des miradors ou placer des systèmes de surveillance dans tout le périmètre du bien naturel.
Du caractère public de ces biens découle le fait qu’aucun marché n’existe pour rendre compte de la réalité économique invisible que cache leur exploitation, le prix des services rendus par les écosystèmes est nul, ce qui induit une surconsommation aboutissant à une surexploitation préludant à leur destruction. C’est pourquoi la « monétisation » des services rendus par les écosystèmes et vue comme le moyen de rendre visible l’économie des écosystèmes, de telle sorte que les coûts environnementaux d’une politique soient internalisés, c’est-à-dire pris en compte dans le processus décisionnel. Par exemple, si le Brésil décide demain d’affecter des hectares de la forêt amazonienne à l’exploitation de nouvelles terres agricoles, il faudra tenir compte du coût de la déforestation de ces territoires en terme de perte de diversité génétique, d’épuration des eaux, de séquestration de carbone, etc. Dans cette optique, la décision ne sera implémentée que si ses bénéfices (rendements agricoles, emplois créés, etc) excèdent les coûts de la déforestation.
Deux types de méthodes
Bien. A présent, la question est de savoir si cette méthode est pertinente, c’est-à-dire si elle se donne l’objectif de ses moyens, soit, l’exploitation efficiente des écosystèmes i.e. la consommation optimale des services qu’ils rendent aux humains. J’insiste, cette question est fondamentale.
A ce sujet, je commencerais par observer que deux types de méthodes sont utilisés pour monétiser les services rendus par les écosystèmes. Les premières émanent de l’approche basée sur les préférences des agents économiques et sont utilisées par les économistes dans la branche de l’économie environnementale. Les secondes émanent de l’approche biophysique et sont utilisées par les biologistes et bioingénieurs (voir tableau). Le cadre conceptuel de référence de l’approche économique est le paradigme néoclassique alors que celui de l’approche biologique est l’écologie (pour un aperçu plus large voir article : Transition écologique : Reformater la pensée occidentale).
La logique des méthodes basées sur les préférences est d’inférer la valeur monétaire des services rendus par les écosystèmes directement ou indirectement à partir des préférences des individus. Par exemple, on va demander aux gens combien ils sont prêts à payer pour protéger une espèce, une zone naturelle, etc (approche indirecte) ou alors, on va prendre en compte le coût du carburant utilisé pour se déplacer pour aller faire une promenade en forêt (approche directe). Autre exemple : des variations de prix sur le marché de biens immobiliers similaires, l’un situé en zone polluée et l’autre pas, on va déduire la valeur d’un « air sain », soit, le montant que les gens sont prêts à payer pour acquérir un bien immobilier situé dans un lieu où l’air est moins pollué.
L’approche biologique est quant à elle basée sur les propriétés intrinsèques des écosystèmes : leur capacité de résilience, leur bio productivité, leur diversité et rareté génétique. Par exemple, les plantes absorbent les rayons lumineux via le mécanisme de la photosynthèse et utilisent cette énergie pour créer de la matière organique. Cette capacité bio productive est variable d’une espèce à l’autre, ce qui va justifier qu’une plante soit évaluée plus cher qu’une autre.
Critique de l’approche mercantile
Je rejette la pertinence de l’approche économique dominante, soit, néoclassique, car elle présente un biais intellectuel qui hypothèque sa pertinence : elle n’est pas ancrée dans la réalité matérielle, c’est-à-dire biophysique, des processus qu’elle essaye d’évaluer. Les préférences d’individus ne peuvent rendre compte de la valeur objective des services rendus par l’environnement, elles ne rendent compte que de leur valeur subjective. Par exemple, deux forêts fournissant des services environnementaux (filtration de l’air, séquestration de carbone, etc) identiques peuvent être évaluées différemment en fonction de la réalité socio-économique des individus qui usent de ces services.
Mais de façon plus générale, je rejette l’approche consistant à monétiser les biens et services rendus par les écosystèmes. Premièrement, car elle se base sur une hypothèse fallacieuse, à savoir que le capital technique et humain se substitue au capital naturel –en réalité, ils sont complémentaires – mais surtout, parce que les caractéristiques biophysiques des écosystèmes hypothèque la pertinence de cette approche. Je note que le rapport Sukhdev fait mention de ces propriétés et en tire les conclusions qui s’imposent sans pour autant les généraliser. Dans les conclusions (p.28), le résumé du rapport précise que « Economic valuation is less useful in situations characterized by non-marginal change, radical uncertainty or ignorance about potential tipping points. In such circumstances, prudent policy should invoke complementary approaches such as the ‘safe minimum standard’or the ‘precautionary principle’. Under conditions of uncertainty it is generally advisable to err on the side of caution and conservation.”
En vérité, le terme “less useful” au début de ce passage devrait faire place au terme “useless”. De plus, les types de situations précisées dans ce paragraphe sont la règle : le fonctionnement des écosystèmes est à ce jour toujours mal compris de la science (la vraie cette fois, pas la science économique). D’ailleurs, le rapport le mentionne explicitement (p.25): « Valuing ecosystem services and biodiversity in monetary terms can be complex and controversial. Biodiversity delivers multiple services from local to global levels, while responses to biodiversity loss range from emotional to utilitarian. At the same time, the natural science underpinning many economic valuations remains poorly understood”.
L’approche bioéconomique : plaidoyer pour une nouveau paradigme
Très bien, mais le sage dira “qu’il est plus facile de déconstruire que de construire”. Si ma critique est si pointue, c’est parce qu’il existe aujourd’hui un courant d’économistes, marginal, qui se réclame d’un nouveau paradigme ancré dans la réalité biophysique des processus naturels : la bioéconomie. Cette nouvelle approche postule que l’économie et la nature sont deux systèmes interdépendants ce qui implique qu’une économie détruisant le système naturel n’est pas viable. En clair, l’activité économique dans s’inscrire dans les LIMITES de la biosphère pour être viable. La notion de limite est le cœur de ce nouveau paradigme. Les écosystèmes possèdent une capacité de résilience i.e. une capacité à continuer à fonctionner dans leurs fonctions essentielles lorsqu’ils sont soumis à un choc, LIMITEE. Prenons le cas des espèces marines par exemple, qui peuvent supporter un taux de salinité situé entre deux limites, une supérieure et l’autre inférieure –ce taux varie entre les espèces. Par exemple, le mulet peut s’enfoncer beaucoup plus loin dans les ports que les autres espèces – (A préciser que ce raisonnement s’applique aussi à l’homme : la résistance de notre corps à des variations de température par exemple est limitée. Ce qui nous différencie des autres espèces animales, et qui nous donne l’illusion d’être en dehors de la nature, de pouvoir la domestiquer, c’est que notre capacité à nous adapter à notre environnement en utilisant le progrès technique est beaucoup plus importante que celle des autres espèces. Du point de vue bioéconomique, mettre un pull chaud par exemple pour nous acclimater au grand froid s’apparente à une mutation génétique externe : la spécificité de l’homme par rapport aux autres espèces est sa capacité à produire des mutations exosomatiques se caractérisant par leur complexité).
La spécificité des bioéconomistes est de prendre en compte le caractère irréversible de la destruction du capital naturel d’une part, et sa complémentarité plutôt que sa « substituabilité » au capital technique d’autre part. Du caractère irréversible de la destruction des écosystèmes et du caractère inter-dépendant de l’économie et de la nature découle l’idée que l’activité économique doit être contenue en deçà des limites, du seuil critique (« tipping point »), où la résilience des écosystèmes vient à être entamée irréversiblement. Problème : cette limite ne peut être connue à priori d’une part et d’autre part, comme le reconnaît le rapport Sukhdev, beaucoup d’incertitude, voire d’ignorance (je ne m’attarderai pas sur la définition de ces termes dans le cadre de cet article) entoure le fonctionnement des écosystèmes. Ceci justifie le recours à une approche précautionneuse, dont le très controversé principe de précaution est l’expression la plus connue, pour protéger la biodiversité.
En fait, c’est très simple, le rythme actuel d’extinction des espèces est 1000 fois plus élevé que le rythme considéré comme naturel par les biologistes. Bien sûr, c’est l’activité humaine qui en est la cause. Ce constat factuel est le signal que nous sommes allées au-delà de la limite. Pour rappel, le paradigme bioéconomique postule l’interdépendance de l’économie et de l’environnement. Donc, sous peine d’hypothéquer notre survie à long terme, nous devons ramener l’impact de l’activité économique dans des limites viables i.e. sous le seuil de résilience des écosystèmes ( à ce propos voir: « croissance verte: nouveau mythe?). C’est ici que l’idée d’empreinte écologique prend tout son sens.
En conclusion, comme je l’ai déjà exprimé dans mon article « transition écologique : reformater la pensée occidentale », l’approche dominante ne permettra pas de résoudre le problème environnemental. Une nouvelle approche, un nouveau paradigme, holistique, ancré dans la réalité des processus biophysiques, est nécessaire. It is about surviving. En fait, le mérite du rapport Sukhdev, de même que celui du rapport Stern, est de nous faire comprendre que le scénario « business as usual » nous mène droit dans le mur. C’est déjà beaucoup.
Dans mon prochain article je discuterai du concept « de biomimétisme » en tant que fondement d’une économie soutenable.
(1) F., Joignot (24 octobre 2010). « Il nous faut inventer une nouvelle économie s’appuyant sur le capital naturel ». Le Monde. Disponible sur : http://www.infosdelaplanete.org/6053/il-nous-faut-inventer-une-nouvelle-economie-s-appuyant-sur-le-capital-naturel.html
